Le soldat augmenté : combattant ou moyen de combat ? État des lieux des défis pour le droit international
Les Champs de Mars, numéro 27, Paris, IRSEM, Presses de SciencesPo, 2021/2 (publié en 2024), pp.47-70.
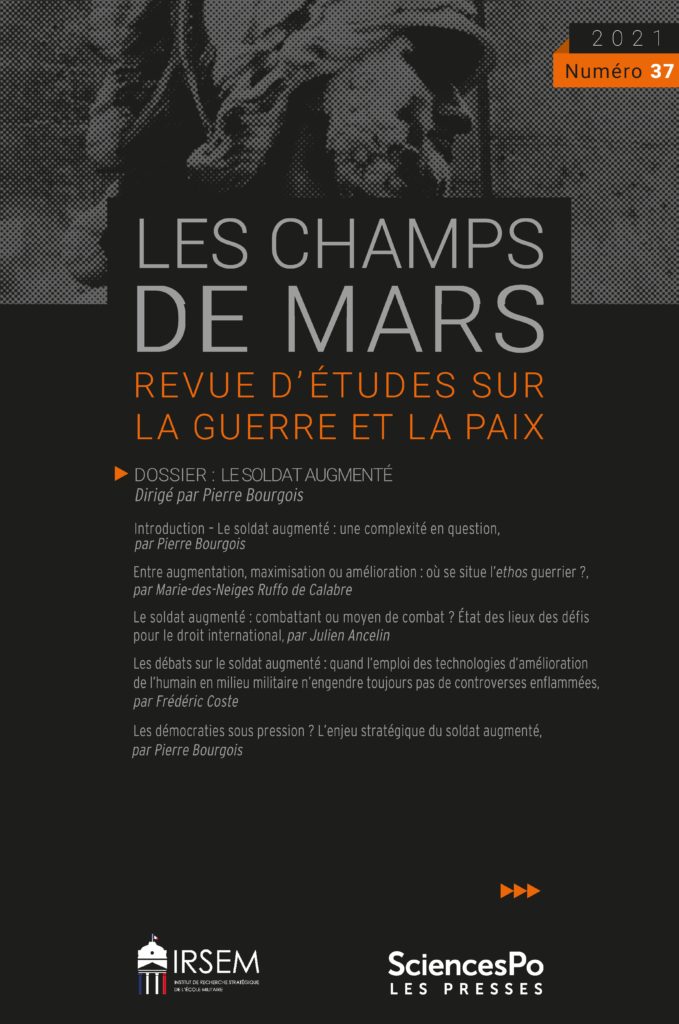
La perspective de la mise au point et du déploiement de soldats augmentés sur les prochains théâtres de conflictualité soulève, pour le droit international, de nombreux questionnements. Sur le plan terminologique, le « soldat augmenté » ne connaît pas de définition unanimement acceptée par les États. Sur le plan substantiel, l’augmentation des capacités des acteurs du conflit amène à questionner l’applicabilité et l’application des règles qui préservent lesindividus et les combattants contre certains excès. L’article confronte les projets d’augmentation du soldat aux garanties dont dispose l’ordre juridique international afin d’éclairer les risques que cette disruption technologique pourra entraîner.
Vous pouvez consulter cette publication sur demande (via le formulaire de contact) ou sur le Portail des Revues scientifiques en SHS Cairn.fr
La position française face à l’autonomie des moyens de combat – Entre détermination et ambiguïté
Annuaire français de droit international pour l’année 2019, Paris, CNRS, 2020, pp.764-783.
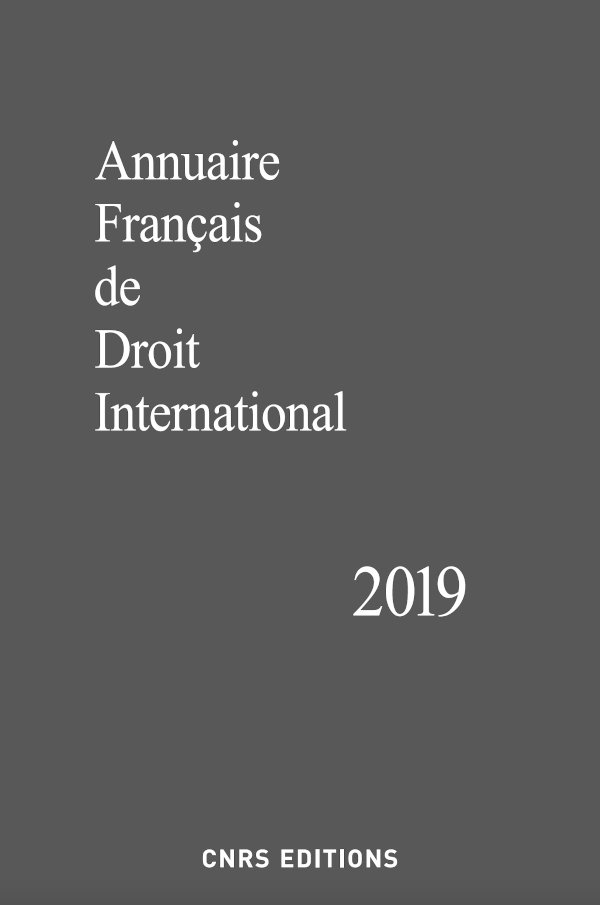
Confrontée aux mutations d’ampleur qu’implique la révolution robotique, la France a progressivement construit une doctrine adaptée aux perspectives que l’autonomie des moyens de combat pouvait engendrer. En retenant une définition stricte de ce qu’est un système autonome, une ligne de partage a été tracée entre, d’une part, les systèmes complètement autonomes dans lesquels l’humain est relégué off the loop et dont la licéité serait exclue et, d’autre part, les systèmes ne comportant qu’une part d’autonomie (incluant notamment les drones) dans lesquels l’humain demeure in ou on the loop et dont la licéité semble majoritairement admise. Néanmoins, l’apparente clarté de cette séparation s’est rapidement dissipée lorsque les échanges internationaux se sont engagés sur l’étendue de ce que devait être l’interaction humain/machine. C’est à ce stade que les principaux risques de contrariété aux normes nationales et internationales sont apparus (notamment en termes de dignité humaine).
Vous pouvez consulter cette publication sur demande (via le formulaire de contact)
La doctrine française d’emploi de moyens de combat pleinement autonomes
Annuaire de l’Association française de droit de la défense et de la sécurité pour l’année 2018, éd. Mare et Martin, 2019, pp.245-254.
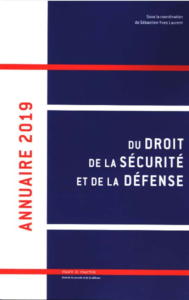
Cet article constitue une contribution à l’Annuaire pour l’année 2019. Il s’agit de proposer une étude de l’approche suivie par la France à face à l’autonomisation des moyens de combat. Confrontée aux mutations d’ampleur qu’implique la révolution robotique, la France a progressivement construit une doctrine adaptée aux perspectives qu’impliquent l’autonomie. Une ligne de partage, en apparence claire, semble avoir été tracée entre, d’une part, les systèmes complètement autonomes dans lesquels l’humain est relégué off the loop et dont la licéité serait exclue et, d’autre part, les systèmes ne comportant qu’une part d’autonomie (incluant notamment les drones) dans lesquels l’humain demeure in ou on the loop.
Vous pouvez retrouver le programme du colloque et consulter cette publication sur demande (via le formulaire de contact) ou par la version papier présentée sur le site des éditions Mare et Martin